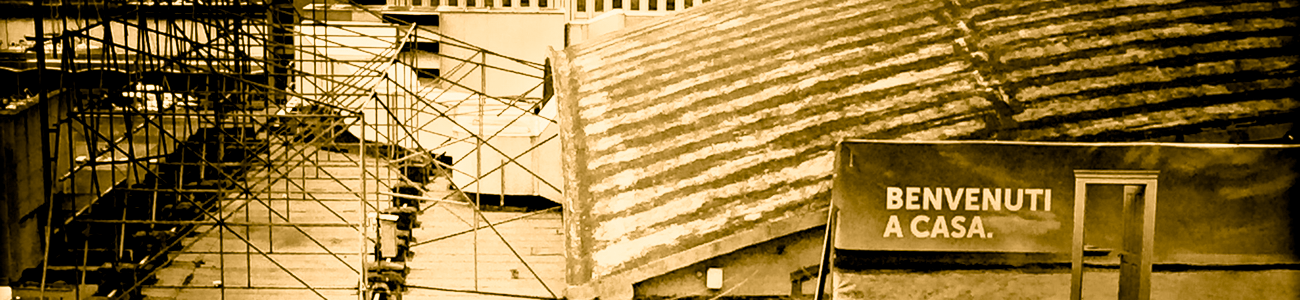que restera-t-il d’un séjour d’écriture à Gênes ? (mars à mai 2025)
la nuit du gorille
Un gorille regarde de quelle manière tombent les étoiles filantes, se gratte le nez et pense que la vie est une chose bien ordonnée.
Plus loin, une soigneuse l’observe. Elle préfère la compagnie de ce primate à celle des autres primates : les hommes.
Un météore bouscule leur destin et provoque la rencontre de ces deux êtres.

Gisèle n’est pas une belle femme, elle n’est pas laide non plus. Elle est ce qu’on appelle « un entre-deux ».
Elle avait ardemment souhaité une place de soigneuse au parc animalier de sa ville et, contre toute attente, elle avait réussi à convaincre le directeur des ressources humaines.
Sans céder à ses avances, précisait-elle avec un sourire malicieux.
Cette résistance l’avait cantonnée au simple rôle de nettoyeuse de la maison des primates. Un bâtiment oblong avec une étrange vitrine à son entrée dans laquelle trônait un petit singe empaillé, costume de fanfare rouge et boutons dorés. Selon la légende, sur une étiquette rédigée à la main, il était affirmé que la bête était mort de la grippe espagnole.
veillées avec lecture au Grand Cargo
L’écriture est un voyage sédentaire et solitaire dont on rapporte des impressions et l’espoir d’une explication du monde.
L’écrit se partage, c’est le moment où le travail cherche son sens, parce que le sens de cet acte existe principalement par le ressenti des lecteurs ou des spectateurs. L’écriture sans la transmission de l’écrit est un miroir sans reflet.
Comment savoir quel humain nous sommes, si nous refusons le regard de l’autre ?
Au mois de juin, je proposerai aux spectateurs quelques soirées de lecture des écrits de Gênes, quel que soit l’état du travail.
Cela fait partie de la nécessaire prise de risque afin de se connaître.
Juste après l’ouverture des portes, un visiteur s’était accoté à la baie vitrée donnant sur la maison des gorilles, sans se préoccuper le moins du monde des locataires. L’endroit sembla confortable à l’intrus pour entreprendre la lecture d’un essai, La condition de l’homme moderne par la philosophe Hannah Arendt.
Intrigué, Édouard s’approcha. Il s’installa de l’autre côté du vitrage adoptant, une parfaite symétrie de position, apparaissant comme le reflet démesuré du lecteur. Par intermittence, la bête jetait des coups d’œil par-dessus son épaule velue et restait fascinée par le mouvement et l’élégance des pages tournées, puis par la surprise renouvelée, à chaque changement, d’un dessin différent formé par l’agencement de l’écriture. Sous son regard et sans en comprendre la cause, la ponctuation, les voyelles et les consonnes commencèrent à s’ordonner dans les flots d’une rivière de phrases. Édouard déchiffra graduellement les propos de la philosophe comme un explorateur découvre, grâce à l’intuition, son chemin au travers d’une carte imparfaite.
À midi, il savait lire.
le résident
- Yves Robert
 Yves Robert habite La Chaux-de-Fonds en Suisse. Il est l’auteur de vingt pièces de théâtre, ainsi que deux adaptations de romans destinées à la scène.
Yves Robert habite La Chaux-de-Fonds en Suisse. Il est l’auteur de vingt pièces de théâtre, ainsi que deux adaptations de romans destinées à la scène.
les miettes de l’ombre

Partir en résidence, c’est partir pour un voyage.
Comme on fait ses bagages, on prépare son travail, on réunit les miettes tombées sur la nappe et on les recueille dans la paume. D’un élan, elles peuvent devenir une poussière qui s’enfuit sur le vent, ou ce plaisir maigre et croquant qui rappelle la saveur des petits-déjeuners.
J’ai préparé quelques-unes de ces miettes et je les garde précieusement au fond de ma poche. À gênes, elles deviendront le souvenir d’un pain, chaud et craquant, alors je pourrai écrire une histoire.
Le récit s’intitule : Les Miettes de l’ombre.
Ce titre a la fragilité des titres de travail, pourtant il contient quelques promesses.
Nous pourrions simplement dire que deux hommes, au bord d’une falaise, d’un océan, se remémorent le parcours de leurs vies. Ils se souviennent de leurs faiblesses, de leurs joies et surtout des actes qui ont fait d’eux, des monstres.
La première image est celle d’un homme basculant en arrière, lentement, sans pouvoir ou vouloir se retenir.
Sous ses pieds, un vide indescriptible.
Sa silhouette se détache devant une obscurité si profonde qu’il est impossible de percevoir les détails. Le lointain dégage l’impression d’être une forêt frémissante arcboutée contre la paroi lisse d’un ciel sans étoiles. Devant, le corps de l’homme est illuminé faiblement par une unique clarté, un trait latéral esquissant une limite sans partage entre l’ombre et la lumière, comme si la représentation du monde s’évertuait à tisser une partition sans no man’s land.
C’est une tromperie.
La bascule amorcée est éternelle, toujours recommencée.
Un bronze anthracite à la façon de Rodin.
Les yeux de l’homme sont clos. Un bras jeté en avant projette une main ouverte, comme éclatée, s’agrippant à ce qui n’existe pas. L’homme reste figé, la figure marquée par une désespérance similaire à celle d’un alpiniste perdant appui et prise. Son visage révèle le paradoxe d’une contraction instinctive chargée de frayeur et d’impuissance entremêlée avec le relâchement et l’acceptation.
Enfin, il se tourne vers moi, les yeux toujours clos, et annonce dans un sourire contraint :
– Les nouvelles sont mauvaises.
Le déséquilibre le gagne.
A portée à lui, d’un geste rapide, je pourrais le retenir. Je suis d’un caractère lent, qui regarde, écoute, mais tarde à intervenir. Dans le ciel venteux, un nuage se déchire à la manière d’un papier buvard rongé par l’humidité, masse soudainement défaite.
La déchirure laisse passer la lueur de la lune, morsure d’une froideur brève et interminable. L’homme ouvre les yeux :
– J’aimerais te montrer le bord de la falaise… Ce n’est pas loin.
– Il y a de la brume.
– Avec de la chance, nous regarderons les albatros.
Ce sont de vieux messieurs sans nostalgies, sans regret, sans haine et sans amour, juste un peu de lucidité comme viatique.
Le bord de l’abime est si proche, les albatros volent au-dessus d’eux et la neige arrive par bourrasque. Au loin, les tamtams de la guerre, la lueur du phosphore et l’indifférence des vagues.
Voilà le décor de cette fin de parcours.
Le ciel est étrange avec sa lumière lunaire.
Des brassées d’étincelles foudroyantes se précipitent en tourbillonnant vers le sol. Des flocons hors saison blanchissent le paysage et interrompent l’été indien s’attardant. Bientôt nous marcherons pieds nus dans la neige nouvelle. Nous préserverons nos sourires d’enfants en refoulant la douleur des engelures. Une grimace burlesque s’affichant comme un défi armé par l’arrogance de conquérir l’Univers, quoiqu’il arrive.
Pourtant, en cette nuit, lui et moi, ne sommes plus au temps des conquêtes. La blancheur de nos cheveux indique que nous sommes arrivés à l’âge des abandons et du désagrégement.
soutiens et partenaires